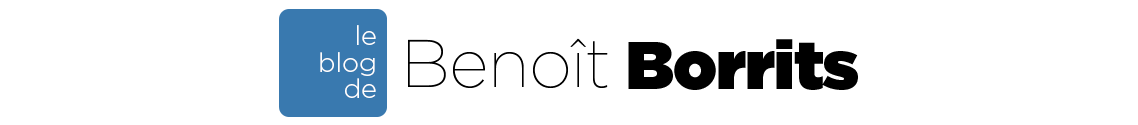Dépasser le capital par la cotisation sociale
Le capital joue un rôle d’assureur privé des investissements et, dans une très faible mesure, des salaires. La crise du covid-19 vient de nous montrer combien ce système est défaillant, a été et sera encore producteur de chômage et de précarité. Le cotisation sociale est une forme collective de gestion du risque. Ne peut-elle pas devenir une alternative très concrète ?
Le risque santé peut être assuré de deux façons différentes : en souscrivant individuellement une police d’assurance ou en participant à un régime obligatoire basé sur la cotisation sociale. Dans le second cas, c’est la solidarité collective qui permet de garantir à chacun des participants la couverture de ce risque, alors que dans le premier, c’est le capital de la compagnie d’assurance qui le fait : en mettant leur argent en garantie, des apporteurs de capitaux entendent réaliser un bénéfice. Or ce caractère assurantiel du capital ne se limite pas aux seules compagnies d’assurance.
L’assurance santé, de la mutuelle au régime obligatoire
La santé est essentielle à la qualité de vie. Elle est aussi fortement imprévisible. On a, très tôt, cherché à s’assurer contre ce risque par des mutuelles. Il s’agit de regroupements d’individus qui mettent de l’argent dans un pot commun, lequel servira à payer les frais de santé des membres du groupe qui en auront besoin. Un des principes d’origine des mutuelles est la solidarité infinie : si d’aventure, le fonds commun s’avère insuffisant, alors les individus verseront des cotisations supplémentaires.
Très vite, le risque médical intéressera le capital et les premières sociétés privées feront leur apparition pour concurrencer ces mutuelles. L’objectif premier n’est alors plus de garantir la santé à des membres mais d’offrir des services d’assurance à des clients dans l’objectif de gagner de l’argent. La compagnie d’assurance propose des contrats dans lequel le risque de chaque souscripteur est mesuré pour établir une prime d’assurance. Son objectif est de faire une marge entre la prime encaissée et les frais de santé qu’elle aura à débourser, attendu que nous restons dans l’incertitude et que celle-ci gagnera sur certains contrats et perdra sur d’autres. Le capital que vont apporter les actionnaires sert à couvrir le risque. Si la société est en perte et que les fonds propres (le capital et les résultats non distribués) s’avèrent insuffisants, alors la société sera en faillite et les clients ne seront donc plus assurés. C’est la raison pour laquelle la profession d’assureur est strictement encadrée par des organismes publics qui réglementent cette activité.
Les mutuelles cohabitent avec les assurances privées et les législations ont tendance à uniformiser les règles prudentielles : les mutuelles, tout comme les assurances privées, doivent développer des fonds propres de façon à assurer la solvabilité du risque. Les fonds propres des mutuelles n’appartiennent à personne et ne servent qu’à garantir le risque alors que ceux des assurances privées appartiennent aux actionnaires qui en extraient régulièrement des dividendes. Entre ces deux types d’entité, il y a donc bien une différence d’approches, l’une basée sur l’assurance mutuelle d’un risque, l’autre sur le contrat, source de revenus pour le détenteur de capital. Cependant, cette banalisation de la mutuelle par l’introduction des fonds propres se comprend par le caractère volontaire de l’adhésion à la mutuelle. Qui voudrait adhérer à une mutuelle endettée qui pratiquerait de fortes primes d’assurance pour se redresser ? Le caractère volontaire de l’adhésion est sa principale faiblesse.
La réponse à cette question est le régime de l’assurance-santé obligatoire qui a été mis en place en France en 1946. Le principe est simple : tout salarié cotise de façon obligatoire à une gigantesque mutuelle qui assure le risque. Tout salarié qui aura besoin de soins y accédera gratuitement et le budget de l’assurance santé est déterminé par les cotisations. Celles-ci pourront croître ou éventuellement baisser en fonction des besoins. Mais il n’est nullement nécessaire de disposer d’un capital pour que le système puisse fonctionner : c’est la solidarité collective et obligatoire qui remplace le capital.
L’expérience nous a montré qu’en terme d’efficacité économique, les pays ayant des systèmes de santé obligatoires dépensent moins (10 % environ du PIB) que les pays qui fonctionnent sur la base des assurances privées : la santé représente 14 % du PIB des États-Unis, alors que certains de ses résidents n’ont pas de couverture médicale. Ne serait-il pas tentant d’appliquer le principe de la cotisation sociale à l’ensemble de l’économie et de ne pas se limiter au seul secteur de la santé ?
Le capital de l’entreprise comme assurance
Il est possible de considérer que toute société de capitaux – et pas seulement les compagnies d’assurance – joue un rôle assurantiel dans le cadre de l’économie. Une société de capitaux va réaliser des investissements dans des outils de production – machines, équipements, immobiliers – dont on ne connaît pas a priori la pertinence. Si l’investissement s’avère être une erreur, ce sont les propriétaires qui en feront les frais sur leurs fonds propres, tout comme les compagnies d’assurance qui auraient mal évalué le risque. Il est possible que la société de capitaux ait recours à l’emprunt pour réaliser un investissement. Ceci ne change guère la donne car ils prennent le risque en première ligne : si l’investissement s’avère être une erreur, ils devront de toute façon rembourser l’emprunt et les fonds propres en seront affectés. Toutefois, et tout comme une compagnie d’assurance qui fait faillite et laisse ses assurés sans couverture, si la société est incapable d’honorer ses engagements, les différents créanciers ne seront peut-être pas remboursés et supporteront le coût de cette erreur de la société de capitaux.
Ce rôle d’assureur de la société de capitaux porte autant sur les achats réalisés auprès d’autres entreprises que vis-à-vis de ses travailleurs. Comme ces derniers réalisent la valeur ajoutée de l’entreprise, la logique voudrait qu’ils en touchent l’intégralité. Mais dans un tel cas, la société de capitaux ne réaliserait aucune marge et cesserait d’avoir un intérêt pour ses actionnaires. C’est ce qui explique la relation salariale : le travailleur échange sa force de travail contre un salaire, lequel lui est garanti en échange de son obéissance aux ordres d’une direction nommée par les actionnaires.
Au XIXe siècle, le salariat s’apparentait principalement à un contrat de louage de bras : l’entrepreneur embauchait à la journée en fonction de ses prévisions immédiates. La possession d’un capital lui permettait de proposer un prix du travail supérieur à ce qu’un indépendant sans capital pouvait produire mais la garantie qu’il proposait était faible : il avait la liberté de ne pas réembaucher le lendemain si son carnet de commandes était faible. En clair, il était dans une position très enviable où son risque principal était celui de son engagement en équipements de longue durée.
Les luttes sociales ont apporté un renforcement des sécurités de rémunération des salarié.es. Le droit social impose des rémunérations minimums. Les conventions collectives permettent un début de reconnaissance de la qualification. Le contrat de travail est désormais encadré et n’autorise que des licenciements justifiés et ce, avec le respect de préavis plus ou moins longs. Si le licenciement n’est pas justifié, l’entreprise s’expose à des indemnités et parfois même à une réintégration du salarié avec le paiement de tous les arriérés, comme cela était autrefois le cas en Espagne et en Italie. Cependant, si ces législations imposent que les entreprises respectent ces règles en cas d’embauche, elles n’imposent aucunement qu’elles embauchent les personnes qui souhaitent travailler, ce qui limite largement l’intérêt du capital.
Vis-à-vis des salaires, le caractère assurantiel du capital a été renforcé tout au long du XXe siècle. Ces avancées ont cependant été battues en brèche sur les dernières décennies. Pire, le capital tend de plus en plus à contourner le droit du travail en utilisant l’intérim ou le statut de l’indépendant pour s’affranchir de toute obligation. Le caractère assurantiel du capital à l’égard du travail tend aujourd’hui à s’amoindrir et ce, pour une raison simple à expliquer : s’il est concevable d’être exigeant vis-à-vis de grosses sociétés qui disposent de capacités de retournement, il n’en est pas forcément de même des petites entreprises. Il y a d’ailleurs souvent des différences de législation en fonction de la taille des entreprises. Mais il est intéressant de noter qu’au XXe siècle, sont aussi apparues les cotisations sociales dans d’autres domaines que l’assurance santé et que celles-ci commencent à mutualiser certains revenus.
Les cotisations sociales
Si les entreprises peuvent licencier, les salariés se sont vus reconnaître des droits au chômage sur une certaine période. De même, en cas d’incapacité de travailler pour des raisons de santé, des indemnités maladies sont versées. Enfin, à partir d’un certain âge, les travailleurs vont toucher des revenus sans avoir à occuper un emploi.
On retrouve donc ici ce même parallèle qu’avec le secteur spécifique de la santé. Le capital ne peut pas tout et à un moment donné, une solution d’assurance collective est infiniment plus efficace que sa sollicitation à l’infini. Ces cotisations sociales sont donc une réponse pertinente concernant la sécurisation des revenus. Elles sont une solution fondamentalement anticapitaliste au sens où il n’y a pas besoin de capital pour garantir ces prestations car celles-ci sont fondées sur la solidarité collective. Elles réalisent une socialisation d’une partie du revenu que produisent les salariés et des législations ont imposé que ces cotisations fassent partie du salaire. Elles sont donc une garantie supplémentaire et collective de sécurisation des revenus des salariés dont les sociétés de capitaux se passeraient bien volontiers d’ailleurs.
La crise du Covid-19 et le sauvetage de l’économie
Cette crise nous a montré combien le caractère assurantiel du capital était faible pour le salariat. Les sociétés qui se sont retrouvées de facto fermées ont immédiatement arrêté les contrats d’intérim, ont mis fin aux périodes d’essai et n’ont pas renouvelé les CDD. Pour le reste, le gouvernement a immédiatement levé l’obligation de payer les cotisations sociales pour l’ensemble des entreprises ouvrant la voie à des remises définitives de celles-ci pour les secteurs les plus touchés. Afin que les entreprises ne mettent pas fin aux CDI, le gouvernement a mis en place des mesures de chômage technique qui garantissaient aux salariés un maintien partiel de leurs revenus. Pour le dire clairement, le caractère assurantiel du salariat n’était pas très important et pour que les sociétés ne licencient pas de trop et/ou ne soient pas en faillite, l’État s’est porté à leur secours pour les maintenir tant bien que mal pendant le confinement. Mais ces mesures de chômage partiel ne pourront se maintenir indéfiniment et les plans de licenciements commencent à être dévoilés.
Ces mesures ont été décidées au nom du sauvetage de l’économie. Il y avait effectivement un risque systémique : les entreprises sont liées les unes aux autres par un ensemble d’obligations, dont celle de payer les factures des fournisseurs. Si une société de capitaux fait faillite – et cela peut provenir du non paiement des salaires – il est probable que cette même société ne puisse pas honorer le paiement de ses fournisseurs et que cela entraîne d’autres faillites. Ceci nous montre à quel point le capitalisme est un système fragile et que le rôle assurantiel du capital porte en lui un risque systémique, tout comme les produits financiers dérivés qui sont aussi des produits d’assurance. C’est ce risque de faillites en série que le gouvernement a évité en suspendant les cotisations sociales et en recourant massivement au chômage partiel.
Une autre approche aurait consisté à faire le distinguo entre la société de capitaux et l’entreprise. L’entreprise est avant tout chose un collectif de travailleurs qui réalisent ensemble une production. Une société de capitaux est une association d’individus qui apportent les capitaux initiaux pour financer l’entreprise et qui, en contrepartie la dirige pour en extraire des profits. Comme les cotisations sociales sont une composante du salaire, nous aurions dû constater la faillite des sociétés de capitaux et de leurs propriétaires, sans que cela entraîne une disruption de l’entreprise : cela pouvait se faire en permettant aux salariés de diriger l’entreprise en lieu et place des actionnaires. Ceci aurait été largement préférable à la procédure de redressement judiciaire dans laquelle les créanciers voient leurs dus gelés, ce qui peut favoriser les faillites en cascades. Mais cela suppose que les salaires soient assurés hors de la sphère de l’entreprise, ce que nous allons proposer plus loin.
Les drames de l’après covid : côté salarial, patronal et environnemental
La sortie de ce plan de secours de « l’économie » s’annonce catastrophique. Cela fait des décennies que nous connaissons du chômage et de la précarité. La crise du coronavirus nous a mis face à cette terrible réalité : dans un pays aussi riche que le nôtre, des personnes ont eu faim car elles se sont trouvées sans ressources du jour au lendemain. Des faillites de sociétés s’annoncent, des plans de licenciements se préparent. Le chômage va bondir de nouveau. La situation qui prévalait avant la crise sera pire demain. C’est ce qui s’annonce côté salarial.
Du côté des personnes qui détiennent des portefeuilles d’actions, la vie n’est pas si mauvaise que cela. Certes, elles ont encaissé des pertes sur certains secteurs mais sur le fond, détenir un portefeuille n’est pas donné à tout le monde et elles ne sont jamais qu’un peu moins riches. Mais le capital a une autre réalité, celle d’individus qui ont investi leur propre argent dans un hôtel, un restaurant, un commerce ou une petite société, et qui, du fait d’une pandémie dont ils ne sont en rien responsables, vont perdre la totalité de ce qu’ils ont mis dans l’entreprise. Nous vivons dans une société qui vante la prise de risque, qui salue ces aventuriers des temps modernes que seraient les entrepreneurs et qui va laisser un certain nombre d’entre eux ruinés et parfois même endettés à vie si ceux-ci ont eu le malheur de signer une caution solidaire sur les prêts bancaires qu’a contractés l’entreprise. Ces personnes se sont engagées à fond dans le grand loto du capital, ont parfois été de vrais exploiteurs ou à l’inverse ont été largement sous-payés. Il ne s’agit pas ici de porter un jugement moral mais de constater l’absurdité d’un système qu’il est de plus en plus difficile à défendre.
Alors que le caractère assurantiel du capitalisme a été mis en défaut durant la crise du covid-19 et menaçait de provoquer des défauts en cascade, il a été sauvé artificiellement par une intervention massive de l’État et de la Banque centrale européenne. Il apparaît maintenant que ce sauvetage n’a été que temporaire, que de nombreuses entreprises seront en faillite et que des grandes sociétés préparent déjà des plans de licenciements pour les mois à venir. Cela fait quatre décennies que nos économies connaissent l’exclusion et la précarité et nous allons sortir de cette crise avec un chômage encore plus fort. Alors qu’il est urgent pour le climat de réduire certaines de nos productions non essentielles, de réduire en conséquence le temps de travail et de profiter de plus de temps libre, voilà que la petite musique de la relance se fait jour, affublée de son épithète Green deal. Non seulement le chômage et la précarité ne disparaîtront pas mais le réchauffement climatique et l’effondrement écologique sera plus certain que jamais.
Quelle alternative ?
Si le capital est l’assureur des salaires, il agit alors comme les sociétés privées d’assurance : chaque société de capitaux choisit les personnes qui peuvent travailler chez elle, et qui sont susceptibles de lui rapporter de l’argent. Pour que les sociétés de capitaux embauchent la totalité des personnes qui le souhaitent, il faut donc des politiques de stimulation de l’activité. Et si cela s’avère insuffisant ou inopérant, on rentre alors dans des politiques d’État employeur en dernier ressort qui de facto divise le salariat.
Aborder les rémunérations sur l’angle du régime obligatoire impose une approche exactement opposée. Il s’agit de poser en principe que toute personne a droit à un revenu parce qu’elle a le droit de vivre décemment. Ce revenu correspond à des droits d’acheter la production. Dès lors, ceci ouvre le débat sur la contrepartie de ce revenu. Est-ce que tout ou partie de ce revenu est inconditionnel ou doit-il être obtenu en contrepartie d’un travail et si oui, selon quelles modalités doit-on obliger les personnes à accepter un emploi ? Mais poser cette question suppose que l’ensemble des unités de production soient en mesure de proposer des emplois.
C’est ici que le Salaire minimum socialisé (SMS) est essentiel en tant que régime obligatoire. Il mutualise une partie du revenu des entreprises en la répartissant en fonction du nombre de salariés. Pour donner un ordre d’idée, si on garantissait à chaque salarié le paiement du Smic actuel (avec l’ensemble de ses cotisations sociales), il faudrait prélever 54 % de la valeur ajoutée des entreprises. Ceci signifie que 54 % de la rémunération de chaque individu n’est plus déterminée par le jeu du marché : il s’agit ici d’une socialisation partielle. On pourra bien sûr diminuer cette part. On peut aussi moduler celle-ci en fonction de l’expérience des individus. On peut aussi rendre cette allocation inconditionnelle en la versant directement aux individus. Tout ceci est l’objet de délibérations politiques et constitue de fait une rupture profonde avec la situation actuelle dans laquelle le revenu est la contrepartie de la valorisation marchande de la force de travail. Cette socialisation d’une partie du revenu permet d’assurer un revenu à chaque unité de production pour toute personne employée, ce qui ne peut qu’inciter à embaucher et assurer ainsi une garantie de plein emploi.
Le second risque qu’assurait le capital était l’investissement. On ne pourra jamais interdire à quelqu’un d’investir son argent dans une entreprise s’il y travaille mais on peut raisonnablement penser que tout le monde préférera financer ses investissements de façon externe. Là encore, la réponse se trouve dans un système financier socialisé dont la sécurité est assurée par des cotisations obligatoires. Il faudra donc que l’intégralité des actifs des entreprises soient financée par emprunts afin de faire disparaître la notion de capital et de fonds propres. Ces emprunts seront réalisés par des banques qui, comme les autres entreprises, seront autogérées par leurs salarié.es. Ceci sera possible par la présence d’un fonds socialisé d’investissements qui aura des objectifs en terme de nature d’investissements et qui pourra remplacer ce qui ne pouvait qu’être financé par des fonds propres. Ce fonds prêtera aux banques à des taux d’intérêt aussi bien positifs que négatifs. Le démarrage comme l’équilibre de ce fonds sera assuré par un système de cotisations permettant une mutualisation générale du risque propre à l’investissement.
Au nom du risque assurantiel pris par le capital sur les investissements, celui-ci dirige les entreprises en lieu et place de celles et de ceux qui y travaillent, ce qui limite très fortement la démocratie dans nos sociétés. Qui plus est, la garantie qu’offre le capital sur les salaires est extrêmement faible, le chômage et la précarité étant largement présents dans nos sociétés. Seule, une extension du principe de l’assurance collective à l’investissement et aux revenus sera de nature à démocratiser pleinement l’économie en permettant d’effectuer des choix collectifs tout en garantissant des revenus à toutes et à tous.
Photo by Ulises Baga on Unsplash